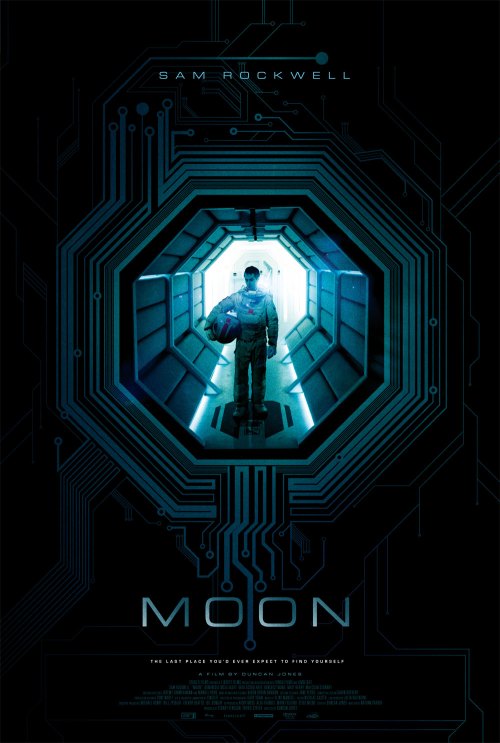La cellule sans barreaux est le design ultime de l’homme moderne. Que l’on se tienne en position du fœtus ou avachi, l’endroit donne un sens à la captivité. Chacun dans sa boîte, le plus loin possible des autres. Les portes oscillent entre la liberté arbitraire et l’insécurité séculaire. Alors, dès que j’entame le dernier tour dans la serrure, je tente de me convaincre que je peux m’en passer. Mais je suis l’homme du temps qui fuit, pas de celui qui passe. Je suis l’homme pragmatique qui préfère jouir au conditionnel plutôt que de témoigner du temps réel. Je suis l’homme urbain, à la vie bien cintrée, qui ne se soucie guère du charme passéiste de la campagne.
Pour tout dire, je n’aime pas, enfin je déteste, non, à vrai dire je hais la campagne et la dictature de la nature. À mon sens lorsque que les gens bien sous tous rapports me condamnent à un dîner bio sous prétexte d’un romantisme écologique, par idéologie de saison ou pour faire comme tout le monde, j’ai l’impression d’être un vestige cannibale baignant dans le cholestérol, enlevé par des écowarriors habillés par Agnès B. De nos jours, le premier des penseurs d’opérette ouvre sa secte gastronomique pourvu qu’il y ait un pèlerin à la soupe. Évidemment, ces VRP du bien, du bon et du beau ne peuvent s’empêcher de justifier leur mascarade alimentaire qui écœure n’importe quel smicard : « Tu sais, mon ami, il faut bien prendre soin de soi ! » En effet, des UV, une pute de luxe, une thérapie, ou manger bio, les gens qui ont les moyens de s’ennuyer trouvent toujours une solution pour faire de leur nombril un combat légitime…
J’aime le jeu, j’aime le risque. La ville réglemente au mieux mon existence, alors je joue parfois avec le feu et je me brûle toujours. Mais, apparemment, j’ai la réputation d’être un homme de parole. Et, dans mon métier, la parole, c’est tout ce que l’on a, donc je paie mes dettes. C’est ainsi que, la mine déconfite, les épaules lâches et le cœur las, je me suis retrouvé – entre les promesses de l’aube et le chant des éboueurs – à faire le pied de grue accompagné de mon nécessaire de survie en attendant les fameux gens bien. C’est la même histoire, à chaque expédition suicidaire au-delà de l’autoroute, dans le monde parallèle des départementales et des nationales apportant leur lot de malheurs biologiques, je suis victime des MST de Dame Nature. Démangeaisons nocturnes, allergies saisonnières, piqûres commanditées, morsures exceptionnelles. J’en suis réduit à une communion hypocrite avec la nature, prêt à l’abandon de ma raison en fixant la trotteuse de ma montre ou à une overdose de cortisone. Le week-end s’achève avec toujours le même diagnostic : le changement fait forcément du bien, alors que, me dit-on, je suis trop ethnocentré pour parvenir à le réaliser. Mais, lorsque le périphérique nous prend à la gorge, que le vivre ensemble fait de la pollution une aurore boréale, je reprends des couleurs. Et lorsque la symétrie reprend ses droits sur l’aléatoire et le provisoire, je sais que je suis enfin chez moi !
La ville je l’aime, à la vie, à la mort.
Mes matins sont faits d’ordre et de rigueur. Les choses sont à leur place. La vie devrait ressembler à mon dressing. Un monde sans guerre hygiénique ni misère morale, et encore moins de solidarité épidermique. Un pays où la centrale vapeur est le meilleur système politique, dès l’instant que chaque jour de la semaine correspond à la bonne couleur de la cravate assortie à la droiture jacobine des boutons de manchette. Dans ce petit coin de paradis en bordure de Lyon, je tiens en respect les valeurs criminogènes de la périphérie et la dégénérescence de la reproduction des élites du centre-ville. Personne ne viendra perturber la symphonie du balai urbain par quelques jérémiades territoriales que ce soit. Car il est huit heures juste, le temps de la danse des bouchons salutaire et des suppliques enfantines sur le chemin du savoir.
Quel spectacle ! Aujourd’hui, par la fenêtre, la ville rugit à pleins poumons cancéreux tandis que les automobiles – à crédit et en sursis – mugissent les unes derrières les autres en spéculant sur l’humeur des feux de signalisation. Selon les avis, le colosse tricolore est tantôt psychorigide, tantôt schizophrène, mais jamais, au grand jamais, équitable. Je le trouve rassurant, posté qu’il est entre la route gondolée et les bipèdes trop pressés. Il administre le boulevard des États-Unis comme un onusien, préférant le libre arbitre au code de la route, l’accident bête et définitif à la patience du viager. Fait du métal des rois, dominant son monde quitte à tutoyer les bouleaux, il a la peau couleur camouflage et granuleuse de l’expérience. Il parle peu, il dit oui, non, peut-être. En vert, en rouge, en orange. Et surtout, j’aime son conservatisme. Il n’a pas cédé aux sirènes de la modernité, un piéton rouge et un piéton vert, aucune voix de téléphonie rose prompte à nous faire croire au charme de la rue.
Huit heures trente tapantes. Les enfants sont rentrés à l’école, les pédophiles chez eux. Et la chape de plomb sponsorisée par Rhône-Poulenc se refuse à céder. Dès que l’étuve satisfait les fidèles dans la cuvette lyonnaise, Dieu rechigne à nous pisser dessus. Mais pas le temps de me reposer sur mes lauriers. Clac, clac, clac, clac, clac. L’armée régulière est de retour, les secrétaires de direction poignardent le goudron, qui ne demande que ça, pour rattraper le retard de la veille. Ces impacts se marient à merveille avec le chant en canon des petites cuillères quittant le café pour s’écraser contre les anses des tasses. Lorsque les terrasses de bistrot entrent en scène, c’est que les gens bien travaillent pour nourrir la ville et que les autres l’alimentent en anecdotes. La cité ouvre un à un ses chakras aux plus offrants, aux plus addicts de la caféine.
Le temps passe, malgré la monotonie. Les rideaux métalliques se lèvent pour ponctionner un peu de pouvoir d’achat dans l’anarchie la plus totale. Bien souvent cette cacophonie quotidienne est le moment propice pour profiter des rayons du soleil, qui se moque d’avoir des spectateurs. Mais parfois, je dois prendre part à la mascarade, il me faut sortir en pleine journée, durant ces heures mornes où l’on m’appelle Monsieur ! Certainement à cause de mon âge, peut-être grâce à mon ramage, mais parfois par égard à ces deux billes noires logées dans mes orbites, sans fin ni merci. Ces mêmes billes que mon patron rétribue et qu’il veut à sa table aujourd’hui.
Je n’ai que deux façons d’aborder la traversée de la ville : à pied ou en taxi. Je garde la marche forcenée pour la nuit, car elle est propice à la folie passagère, la fraternité imaginaire, ainsi qu’à la violence animalière. Mais, pour l’heure, le mammifère plantigrade que je suis opte pour le chauffeur de taxi en endossant le rôle de Miss Daisy. Il n’est jamais de bon augure de faire attendre son supérieur hiérarchique. Le mien est le type d’individu improbable, entre l’ancien ministre de la IVe République, le barbouze repenti et le golden boy londonien. Selon lui, on a le chauffeur de taxi et la course que l’on mérite. La manière dont votre pilote déchire l’asphalte est un indicateur de vos motivations intimes. Mais bien sûr… Et aujourd’hui, mon chauffeur parle le verlan, l’argot d’Audiard et un anglais de Kingston, signe, au choix, du progrès tangible de la mondialisation ou preuve que la tour de Babel tient dans un taxi. Lorsqu’il ne tente pas de faire la conversation, le bruit régulier et rassurant du moteur sert de bande-son à ces décors d’après guerre. Certains décors portent les plaques commémoratives de résistants, d’autres abritent des enseignants révisionnistes, et les derniers se réfugient derrière un lifting au nom de la modernité. La ville aime ses tatouages et ses cicatrices – parfois ostentatoires, souvent mérités, jamais superflus –, qui se reflètent dans la crasse du Rhône. Je pourrais donner un nom à chaque bâtiment, identifier chaque ombre, dater chaque ravalement de façade, et même célébrer dignement leurs anniversaires. Je divague, le regard plongé dans le reflet de la vitre, la barbe taillée à la perfection par mon artisan gascon, lorsque soudain le calme précaire se brise sans frappes préventives…
« Regarde-moi, comme si c’était la première fois ! »
– Qu’avez-vous dit, chauffeur ?
– Rien, boss, j’étais en train de céssu une pastille d’la gorge que ma girl m’a dégoté à son taf, c’est son pourliche à elle, boss ! Toute la journée sur ses arpions, elle court sans s’arrêter, elle étiquette des trucs, des bidules et des machins !
– Veuillez m’excuser, mais j’ai bien distinctement entendu une voix, une voix rauque et féminine. Une voix à la Macha, oui c’est précisément ce grain.
– Ça, c’est l’autoradio qui lâche des big tunes, boss. Moi, tous les jours, j’écoute Brigitte Lahaie, c’est la scientifique du zizi pan pan. T’as une grande imagination, trop de boulot. Tu sais, tu devrais…
J’avais déjà dépassé mon quota journalier de sottises avec un seul de mes congénères et, pour obtenir le silence, je le coupe et lui administre un :
– Passons, passons, passez par le quai et déposez-moi ensuite devant l’opéra.
– OK boss, pas de bla bla, de l’action. Yes I Man.
Une fois à destination, mais en retard sur mes cinq minutes d’avance réglementaires, je rémunère le spécimen en énergumène ou l’inverse. Je n’ai pas voulu regarder son visage, j’avais le sentiment qu’il ressemblait à ses mots. Après quelques pas militaires, me voici devant le restaurant. Je me dis qu’en sept ans de service actif c’est bien la première fois que le grand Raymond m’invite à sa table. Et pourtant je suis un de ses plus anciens éléments, de loin le meilleur dans ma catégorie. Et mon métier, peu peuvent le faire. Je suis son employé préféré, celui avec les deux billes noires. À cette heure, la ville se gonfle d’importance et de notes de frais. Alors que je m’encastre entre une table de francs-maçons municipaux et une réunion de DJ subventionnés face au grand Raymond, mon avenir va basculer en une minute montre en main.
L’entreprise, celle qui me permet de prendre l’avion pour aller de ville en ville à travers le monde, ferme. Comme ça, sans questions ni indemnités de licenciement. La voix caverneuse, le goitre tendu, les commissures des lèvres symétriques, son visage buriné dans la pierre depuis Mathusalem laisse filer un peu d’émotion en ordonnant à ses paupières de se fermer, une fois, une seule, pour les rouvrir au bout de dix secondes en laissant une grande expiration bordelaise et cubaine me fouetter le visage. Nous avons poliment bu comme des anciens combattants jusqu’à ce que la nuit tombe sur la capitale des Gaules. Après une étreinte étrange, il me donne finalement un petit papier où est inscrit l’ordre de mon ultime mission. Rien d’exotique cette fois, pas d’avion ni de bateau, l’adresse est de l’autre côté de la rue, en face de chez moi. J’ai jusqu’au petit matin pour m’exécuter. Plus de mots, que des ombres partant dans des directions opposées. Il me reste une longue marche cette nuit pour graver chaque instant jusqu’à mon dernier office.
La route est longue, la perspective se réduit. Les réverbères sous le régime de l’intermittence, la ville se drape de son côté obscur sous le regard avisé de l’astre que nul n’ira décrocher.
Si les cloches n’avaient pas la laïcité nocturne, il serait précisément l’heure du crime. Il y a des signes qui ne trompent pas. Les Britanniques d’occasion claquent du croupion dans leur jean slim dès qu’ils croisent un groupe de malades du myocarde aux casquettes brodées d’un reptile aquatique. Les nymphomanes contrariantes regrettent leur radinerie sur le tissu séparant leurs genoux du viol, tandis que les monogames crucifiés par de multiples maternités jouent à la scène de la nativité, avec du latex, sur la première Albanaise venue. Les uns iront faire des crises d’agoraphobie dans les backrooms que la ville a le chic d’abriter, les autres feront acte de misanthropie sur un banc, accompagnés d’un fond de bouteille. Quoi qu’il en soit, dans les deux cas, personne ne veut rentrer chez soi, dans sa case. À côté, au-dessus, au-dessous d’autres cases. Ce qui nous rappelle que la ville est une conséquence, et que chacun a le même problème. La peur du noir, la peur du silence, la peur du vide, la peur d’être seul.
Dans un moment d’humanité non désiré, la plus grande des avenues se mue en ruelle puis en coupe-gorge. Au royaume des ombres, la ville préfère le son à la matière. Les tressaillements les plus anodins sont source de toutes les phobies lorsque le monstre de pierre devient impalpable. C’est l’effet de la vision nocturne dû à la persistance rétinienne. Il faut bien se persuader de tant de choses pour ne plus avoir peur. À chacun son syndrome de Stockholm. Je l’aime ainsi la ville, sauvage, impartiale et sans remords.
Plus de batterie dans mon baladeur numérique à la mode et le vent se lève enfin. À force de longer les quais, j’ai rejoint le quartier chinois où plus personne ne parle cantonnais, puis le quartier arabe où le shit a connu une curieuse inflation, et enfin le quartier universitaire où l’alcool promet la pilule du lendemain. Et c’est en refusant une charmante proposition pour une quelconque colocation gauchiste à tendance cheguévarienne que j’entends une voix. La même que celle dans le taxi. Je stoppe ma marche, mais plus rien. Juste le sifflement du vent sec dans les arbres. Je n’ai pas suffisamment d’amis de mauvais goût pour avoir droit aux joies d’une caméra cachée, et le bitume me colle depuis si longtemps à la peau que je ne relèverai pas cette occurrence. Cinq cents mètres. Encore cette voix. Je me retourne en opérant une rotation complète, en slow motion, pour tenter de percer à jour la nuit. Bien sûr ! C’est ridicule, mais Michael Bay aurait apprécié !
Dans pareille situation j’incriminerais mon taux d’alcoolémie ou encore la fatigue, mais vu l’absinthe de substitution que j’ai ingurgitée et sachant que j’ai procrastiné toute la journée sur les réseaux sociaux… j’en doute. Je sens comme une certaine angoisse s’emparer de moi. Je serre machinalement ma mâchoire jusqu’au sang. Toutes les dix secondes je braque ma nuque brusquement, quitte à attraper un torticolis. Et la Voix revient. Une, deux, trois, dix fois. L’horizon, toujours pas la moindre réponse à mes questions vociférées à l’obscurité, comme le premier des illuminés. Puis j’arrête, pour repartir. Je perds mon temps et il ne me reste que trois petites heures avant l’expiration de ma mission. Les bâtiments murmurent entre eux lorsque le vent vient les frapper pour un peu de reconnaissance. Mais je sais bien qu’ils se moquent de moi.
Je décide donc de ne plus rien écouter, de presser le pas, de regarder droit devant sans vraiment fixer quoi que ce soit, parlant le plus fort possible dans ma tête. De tout, de rien, du PIB du Tadjikistan, de la course au titre pour le championnat du monde de catch, de la défaite de la pensée, de mon ancienne collection de cartes téléphoniques. Mais rien n’y fait.
Plus je réfléchis fort dans cette boîte crânienne qui ne laisse que peu de place à l’écho, plus je trouve une logique à cette Voix. Ce son apparaît dès qu’il y a une lumière. Et pas n’importe quelle lumière. Sur cet interminable boulevard, tous les cinq cents mètres il y a un feu un de signalisation, et avant lui un réverbère réglementaire. C’est entre les deux que la Voix se manifeste.
Je n’ai pas assez peur pour nier l’évidence et je ne suis pas suffisamment rassuré pour faire marche arrière. Aucune voiture à des kilomètres et, comme par hasard, lorsqu’on en a besoin, encore moins de ronde alcoolisée, statistique et pécheresse de la brigade anticriminalité. À ce moment, plus de nombril à congratuler et plus d’amour-propre à exposer, il ne reste que ce qui fait de nous des animaux différents, cette curiosité obsessionnelle…
À ma droite la civilisation, du bois, de la pierre, du ciment. À ma gauche l’inconnu, le trottoir, la rue et enfin le noir. Je respire par à-coups, mes narines se dilatent et se figent avant de se relâcher. Ma lèvre inférieure est pendante, mes sourcils sont braqués en direction du ciel. Ma gorge est sèche et ma pomme d’Adam réclame un plan Orsec. Je somatise au point de m’inventer de l’arthrite précoce et mon cœur expulse plus de corps étrangers qu’il n’en laisse entrer. Le son de ma voix est resté bloqué, ma tête et ma chaussure droite foulent ce territoire occupé par la lumière du réverbère. À ce moment-là, le feu passe au rouge.
La Voix surgit, comme prévu :
– Alors comme ça, tu comprends lentement, mais tu agis vite. Je suis déçue, je pensais que c’était l’inverse pour un homme de ta trempe !
– Heu… ha… heu…
– Bravo, des onomatopées, c’est tout ce que tu as à me proposer, vraiment ? Je me contenterais presque d’une phrase avec un vulgaire complément d’objet direct tu sais ! Je te propose une performance digne de Jeanne et du bûcher et toi, tu es là, les bras pendants sans rien dire. Tu es créationniste ou juste demeuré ?
– Eh bien, ni l’un ni l’autre.
– Mazette, c’est que le petit monsieur fait dans la concision. C’est la timidité ou la peur ? Hum, tu crois que je ne t’entends pas conchier la Terre entière comme si tu n’étais pas accidentellement de passage ?
– Je ne comprends pas. Mais si cela n’a aucun sens, en quoi mon opinion peut-elle vous intéresser ? D’ailleurs, pourquoi vous dérange-t-elle ? Je ne nuis à personne.
– Tu nuis à mon image de marque ! Les avis je m’en moque, nombriliste sur talonnettes ! Votre époque ne distingue plus le philosophe de l’idiot du village, et la postérité ne dure pas plus longtemps que le tube de l’été. Mais toi, depuis trente ans, jour après jour, tu condamnes le monde, les gens et l’histoire en mon nom. Tu es masochiste ? Tu sais, il y a les cultes pour ça, ou le mariage !
– J’expose simplement une analyse complexe d’un monde qui l’est encore plus !
– Modeste avec ça. Sérieusement, tu aimes à ce point le doux son de ta voix ? Si tu veux avoir raison et être seul, tu as l’ascétisme, les hôpitaux psychiatriques et les rochers – avec la vérité sous le bras en option.
– Je commence à perdre patience, bon c’est pas tout ça, mais je suis un homme moderne, j’ai un ordinateur tactile et il ne me manque plus qu’un skateboard volant, alors voyez-vous les miracles ce n’est plus ce que c’était. Donc voulez-vous, enfin, « toi », « eux », « ils », me lâch…
– Encore un excès d’esprit ! Eh bien, ce que je veux, si tu veux tout savoir, c’est te voir mort ce matin avant le passage des éboueurs, histoire que tu ne te plaignes pas une fois de plus de la coupe de leurs uniformes.
– La mort, rien que ça ?! C’est sentencieux, limite divin et totalement définitif ! Disons que je vais passer mon tour, ma grande, mon grand. Vous êtes brésilien, brésilienne ?
– Très bien, je vois que ton métier te place même au-dessus de ça. Alors écoute, je te laisse prendre ton rail d’adrénaline une dernière fois avant que tu partes les deux pieds devant sans passer par la case cirage de pompes.
– Bon, le mysticisme a ses limites. Je mourrai comme bon me semble, comme Romain Gary, David Carradine ou la carrière de Charlie Sheen. Au revoir, donc.
Agacé, je reprends mon chemin à vive allure sans m’arrêter. Je n’ai pas réussi à échapper au système métrique. Me revoilà au même endroit, mais plus loin, au centre de la lumière, entre le réverbère et le feu de signalisation.
Après quelques secondes de suspense, la Voix, la ville reprend son message prophétique :
– Ce matin, avant que la première poubelle ne soit enlevée sur le boulevard des États-Unis, tu seras allongé face contre terre.
– Alors, au choix, avec ou sans intervention divine, sur place ou à emporter ?
– Tu sais, j’ai tenté maintes fois de t’aiguiller sur la marche à suivre. Je t’ai même donné des exemples, mais rien n’y a fait. Plus je frappais fort, plus tu continuais. Tu dois avoir une piètre vision de l’amour. Quand, je pense à ton chien Belami. Et puis il y a eu ta femme, Chri…
– Enflure, enfoiré de fils de pute ! Crevure de je ne sais pas quoi !!!! Tu es en train de dire que tu as tué ma femme ? Tu as tué ma femme pour me donner une leçon ?
– Ta, ta, ta. Le petit monsieur perd son flegme et ses invectives feutrées ? Tu sais, nous nous ressemblons, j’ai fait preuve du même cynisme que le tien, et puis s’il y a une pute dans cette histoire, c’est toi. Seules les putes ont besoin de se cacher, ont besoin de protection, ont besoin d’une ville. Tu vas mourir, enfin tu n’auras plus peur. Remercie-moi.
– Je vais te crever, tu entends, je vais te crever. Te crever, te cre-veeeer enfoiré !!
– Voyons, sois raisonnable, je suis partout et je suis toi. Adieu.
– Reste ici enfoiré, toi, reviens j’ai dit, réponds-moi. Répooonnnds !!!
Agenouillé par terre, je suis resté sans voix, les phalanges contre le sol, toute l’eau du corps s’échappant inexorablement de mes yeux écarlates. Puis je me suis décidé à me remettre en route, fatalement, par habitude. Je reprends vie et cesse de la commenter comme si j’étais devenu extérieur à moi-même. Mon cœur ne bat plus pour rien. Je n’ai plus personne, mais je suis encore quelqu’un. Alors je fais la seule chose pour laquelle j’ai du talent et encore de l’affection : mon travail. Mon précieux travail est unique et saisonnier, illégal et humaniste. Je ne travaille que trois mois dans l’année, du 21 juin au 31 août. Je remplis une noble tâche qui satisfait tout le monde. Je crée de l’emploi, consolide les mémoires et bâtis des légendes. L’entreprise pour laquelle je travaille est spécialisée dans la postérité pour une clientèle très sélecte : chanteur, homme politique, acteur, écrivain, bimbo.
Les gens ne veulent pas disparaître des mémoires, des archives, de la Terre, de la ville. L’été est une période creuse et les personnes qui ont tutoyé le zénith ne veulent pas partir sans que nul ne s’en souvienne. Alors, quand ces célèbres anonymes veulent que leur nom leur survive, moi qui voudrais oublier le mien – Serge Nanette ! –, j’interviens. Ma profession est de tuer d’anciennes gloires durant l’été, lorsque l’actualité cherche dans la rubrique nécrologique un titre suffisamment gros et respectable pour son lectorat.
Pour ma dernière mission, Raymond m’a ordonné d’abattre un ancien défenseur central de l’Olympique lyonnais des années 1980. Peu importent les raisons du contrat, je remplis toujours mes obligations. Et malgré mes mains calleuses, je vise juste. Ma peau a la couleur de la terre, certains diraient que cela est dû à l’alcoolémie, mais ma maladie s’appelle la mélancolie. Mon visage vient d’une autre époque, celle des traits simples, des traits de caractère. Toute ma vie réside dans ces deux billes noires qui portent le poids coupable de mes cernes immérités. Et comme tout le monde, j’ai de la compassion. La mienne s’humanise dans mes sourcils broussailleux. Mon véhicule, mon corps, est en pilote automatique à la salle de sport et fonctionne à l’adrénaline, il n’y a que cela pour revitaliser mon âme. Je suis trapu comme un boxer et maniéré comme un châtelain. C’est dans ce paradoxe que survit ce maigre équilibre qui me rattache au monde des vivants. L’esthétique de la violence fait de moi un objet en puissance. Presque vivant, toujours absent.
Ma femme, premier violon à l’opéra de Lyon, est partie courant novembre, un soir de Ligue des Champions. Nul ne s’en est préoccupé. Qui est intéressé par l’opéra à part les bailleurs de subventions, quelques érudits endimanchés et les derniers adorateurs de l’exception culturelle peut-être ?
Mon métier tient autant de la mort que de l’art.
Il est l’heure. Discrètement, l’ancien joueur de football m’attend craintif dans son fauteuil de direction, le regard rivé à la fenêtre, vers l’aube persistante. La ville apparaît peu à peu, c’est la dernière fois pour lui. La rosée automatique faisant son office, la pénombre tire sur le taupe puis le bleu délavé, il a un rictus. Avant qu’il relâche celui-ci, ma seringue a déjà pénétré sa carotide avec un poison végétal de ma fabrication, que j’appelle Ivy. Tout son corps se détend d’un seul coup, délivré, plus personne à l’intérieur. Mais, pour les autres, il allait redevenir quelqu’un. Sa femme le découvrira apaisé, serein au milieu de tous ses trophées, de sa gloire. Alors je repars comme je suis venu, sans un bruit, sans une trace, sans un sentiment. Et au pied de l’immeuble de mon dernier client, immobile pendant près d’une demi-heure, ma demi-heure, j’ai eu l’impression d’avoir enfin derrière moi des choses, des gens. Je marche simplement, sans but précis, puis j’arrive sur mon ombre naissante entre le réverbère et la lumière. Et la Voix revient une dernière fois :
– Serge, il faut que je te parle, comment dire…
– Tu en as déjà trop dit, tu en as déjà trop fait. Il n’y a plus de mots, plus de vie, plus de choix.
– Écoute, je…
– Fais ce que tu veux, qui, quoi que tu sois ; je rentre chez moi.
Je fais un pas sur le passage clouté, encore orphelin, quand la vie me passe dessus sans avoir eu la courtoisie de s’annoncer. Le tombeau sur roues des urgences, appelé par la femme du footballeur, me percute de plein fouet. L’impact est bref, irrévocable. Il n’y a plus rien à faire. La logique a ce côté inextricable que le destin cherche en vain au travers de ses prédictions. La ville accueille une fois de plus la lumière dans son berceau de fer industriel et de béton armé. Et puisque chaque spectacle a une fin, les urgentistes gesticulent simultanément, mais je n’entends plus rien, sauf la ville. En chuchotant sur un ton maternel, elle me demande pardon :
– Mais pourquoi ne m’as-tu pas écoutée, je t’avais dit de rester sur le trottoir. Pourquoi ?
– Une question, une seule : que feras-tu lorsqu’il n’y aura plus personne pour croire en toi ?
– Eh bien je mourrai, c’est ce que j’ai toujours voulu, que cette histoire sans fin se termine.
– Dans ce cas, tu peux commencer à avoir peur.
Six heures trente-cinq, les éboueurs en uniforme fluorescent prospectent le boulevard…